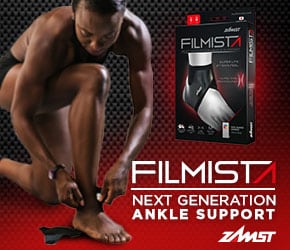Comment trouver chaussure à votre pied ?
Franchement, il n’y a pas plus difficile que trouver la chaussure idéale pour courir. Mais lorsque vous parvenez à élire celle qui correspond à votre pratique et votre morphologie (peut-être dans ce cas plusieurs paires!) c’est la garantie de centaines de kilomètres de pur bonheur ! Choisir une paire de chaussures est une sacrée paire de manches. Pénétrez dans n’importe quel magasin de sport et allez au rayon chaussures : vous allez être confronté à une offre pléthorique où s’entremêlent tout type de couleurs, formes, technologies, prix… Pas évident de s’y retrouver dans une telle jungle, même si les vendeurs spécialisés sont là pour vous guider. Voici quelques conseils pour vous repérer dans l’univers des chaussures de running. Première étape : choisir sa paire de chaussures 1.Les « oversized » Les chaussures oversized, ou maximalistes, ont été démocratisées par la marque Hoka One One. Leur originalité ? Une semelle large, un amorti important et une conception qui pousse naturellement le coureur à basculer vers l’avant du pied grâce à un effet bascule. 2. Les classiques La grande majorité des coureurs utilise des chaussures « classiques », ni oversized, ni minimalistes. L’offre reste d’ailleurs largement centrée sur ce type de modèles dont les marques déclinent à loisir toutes les caractéristiques : rigidité, amorti, crampons, légèreté, largeur du chaussant… 3. Les minimalistes Né aux Etats-Unis, le minimalisme prône le retour à une foulée naturelle grâce à des chaussures dotée d’un drop (la différence de hauteur entre l’arrière et l’avant de la chaussure) inférieur à 4 mm, une semelle très fine (amorti quasi-inexistant), une flexibilité maximale et un chaussant large au niveau des orteils. A la clé : une attaque par l’avant du pied et non plus par le talon ainsi qu’une posture de course profondément modifiée. Soyez prudents avec ce type de chaussures : renseignez-vous et utilisez très progressivement ces modèles car les conséquences sur la gestuelle ne sont pas anodines. Nos conseils pour choisir votre paire : Le design ne fait pas tout ! Ne vous laissez pas influencer par le design, privilégiez votre confort ! Une belle chaussure n’est pas forcément une bonne chaussure pour vous ! Personnalisez Vous pouvez adapter vos chaussures à vos besoins en portant des semelles élaborées par un podologue. Une priorité : les fondamentaux Appliquez à votre équipement le même principe qu’à votre entraînement : la progressivité. Commencez par vous équiper de chaussures performantes mais plutôt polyvalentes et, si vous en ressentez le besoin, tournez-vous plus tard vers des modèles plus spécifiques. Deuxième étape : apprivoiser une paire de chaussures Lorsque vous essayez une paire de chaussures, commencez par appréhender : Le confort immédiat : spontanément, vous sentez-vous bien dans la chaussure ? Le laçage : est-il facile ? Le serrage est-il précis ? Le maintien : votre pied est-il trop serré, trop au large…? Ensuite, faites quelques pas ou, idéalement, sortez de la boutique pour réaliser quelques foulées. Vous pouvez alors évaluer : Le confort en test dynamique : à la course, êtes-vous à l’aise ? Y a-t-il des points de compression, d’inconfort…? La tenue du pied : votre pied est-il suffisamment maintenu pendant la course ? Le dynamisme : la semelle offre-t-elle le renvoi d’énergie qui vous convient ? L’amorti : est-il mou, ferme…? Le déroulé : la chaussure vous permet-elle de dérouler correctement le pied ? L’accroche : vous pouvez vous faire une idée de l’accroche et l’adhérence en observant la semelle (gros crampons ou non, gomme tendre ou dure…). Nos conseils pour finaliser votre choix Priorité : le confort Soyez particulièrement attentifs à votre bien-être : si vous ressentez des points de compression, des frottements… alors que vous n’êtes dans la chaussure que depuis 10 minutes, imaginez ce que cela donnera au bout de plusieurs heures de course ! Ceci dit, certains modèles sont parfois peu confortables lorsqu’ils sont neufs et s’assouplissent au bout de quelques kilomètres. Définir vos attentes Pour bien choisir vos chaussures, vous devez avant tout définir avec précision vos attentes et vos besoins. Votre priorité est-elle le confort, l’amorti, le dynamisme, l’accroche, la fermeté ? Êtes-vous un coureur occasionnel ou un compétiteur ? Courez-vous surtout en ville, sur du bitume, sur des chemins en forêt ou bien en montagne ? Aujourd’hui, il existe des modèles pour chaque type de pratiquant et de terrain. Pousser la porte d’une boutique spécialisée Non, les magasins spécialisés ne sont pas réservés à l’élite ! Les coureurs de tout niveau ont intérêt à fréquenter ces boutiques où les vendeurs, formés, passionnés et bien souvent eux-mêmes coureurs, vous distillent des conseils avisés. Une analyse vidéo de votre foulée sur un tapis peut même vous être proposée; comme par exemple celle du réseau Terre de running. Vie et mort d’une chaussure de running Ça y est : vous avez enfin trouvé la chaussure idéale pour vos petons ! A vous les séances de pur bonheur ! Mais comme toute bonne chose a une fin, vos chaussures fétiches vont s’user. Même s’il est difficile d’énoncer des règles universelles, voici quelques indications pour savoir quand vos chaussures auront rendu l’âme : Plus des chaussures sont légères, plus elles s’usent rapidement. Pour ce type de modèle, on conseille généralement de les changer au bout de 600 km parcourus. Plus vous êtes « lourd », plus vous devez renouveler vos chaussures. Observez l’allure de vos chaussures : amorti affaissé, mesh usé, crampons usés… Soyez attentifs aux signes extérieurs d’usure. Des douleurs inhabituelles apparaissent (genoux, chevilles…) : bien souvent, cela signifie que vos chaussures ne vous protègent plus correctement. Marie Paturel.